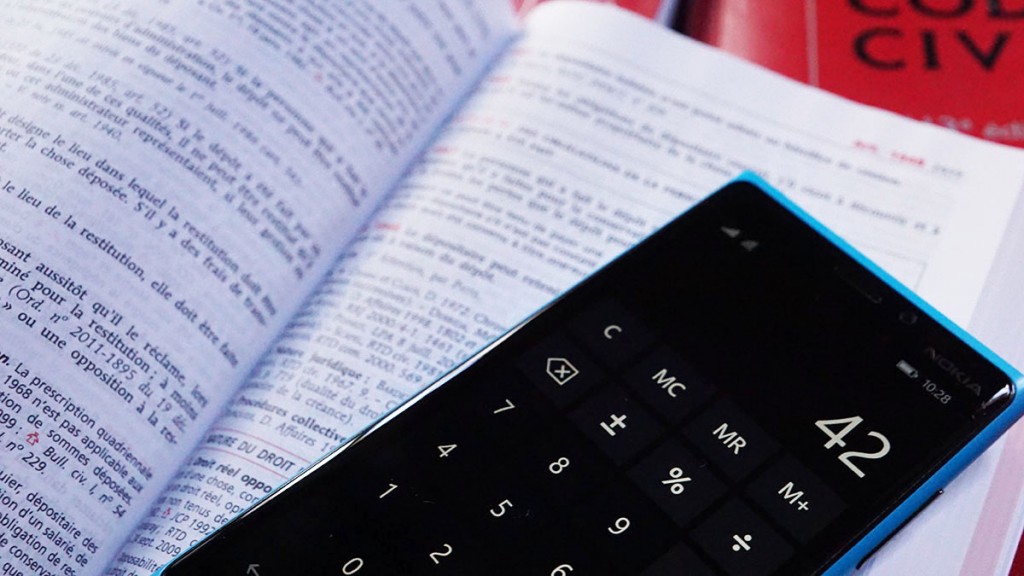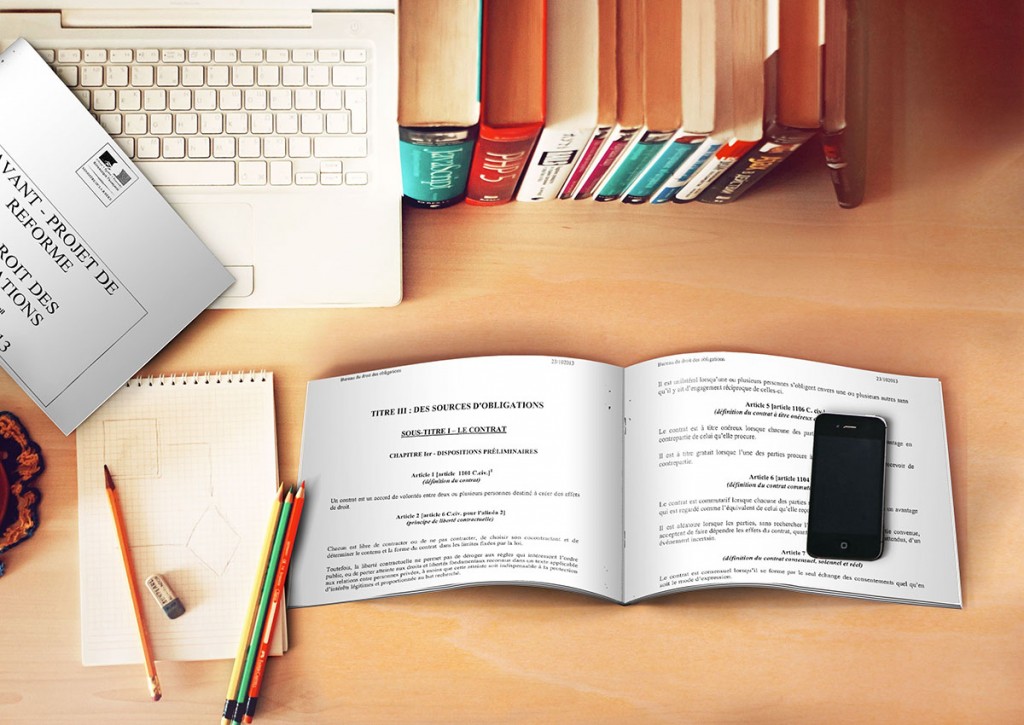Mise à jour du 02/03/2016 : le présent billet a servi d’ébauche à un article plus complet publié au Recueil Dalloz du 3 mars 2016 : « Application dans le temps et incidence sur la jurisprudence antérieure de l’ordonnance de réforme du droit des contrats », D. 2016, chron., p. 506-509. Le Gouvernement a publié aujourd’hui la très attendue ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. La teneur générale du texte était connue depuis que la Chancellerie a publié un projet d’ordonnance l’année dernière, mais une question restait en suspens : celle de l’application dans le temps de la réforme. La question est particulièrement sensible en matière contractuelle puisque le contrat est un outil de prévision, il est donc souhaitable que le législateur ne déjoue pas les prévisions des parties. Ce billet propose une synthèse des dispositions transitoires de l’ordonnance et de l’incidence de celle-ci sur le droit positif.
Le Gouvernement a publié aujourd’hui la très attendue ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. La teneur générale du texte était connue depuis que la Chancellerie a publié un projet d’ordonnance l’année dernière, mais une question restait en suspens : celle de l’application dans le temps de la réforme. La question est particulièrement sensible en matière contractuelle puisque le contrat est un outil de prévision, il est donc souhaitable que le législateur ne déjoue pas les prévisions des parties. Ce billet propose une synthèse des dispositions transitoires de l’ordonnance et de l’incidence de celle-ci sur le droit positif.

L’entrée en vigueur de l’ordonnance le 1er octobre 2016
La date d’entrée en vigueur d’une loi est la date de sa « mise en application », le « moment où le texte devient obligatoire »(1). Selon l’article 1er du Code civil, les lois « entrent en vigueur à la date qu'[elles] fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ».
En l’occurrence l’article 9 de l’ordonnance prévoit que toutes les dispositions de celle-ci entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Ces dispositions ne pourront donc pas être appliquées avant le 1er octobre 2016. Cela ne signifie cependant pas que toutes ces dispositions deviendront applicables à tous les contrats dès le 1er octobre 2016, des distinctions doivent être faites.
L’application dans le temps des dispositions de l’ordonnance
Selon l’article 2 du Code civil, « La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif. » Suite aux propositions de Roubier, la doctrine et la jurisprudence raisonnent désormais essentiellement en termes de situations juridiques. En ce qui concerne les situations juridiques légales formées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, leurs conditions de formation et leurs effets antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle demeurent régis par la loi ancienne (la loi « n’a point d’effet rétroactif », selon l’article 2 du Code civil), cependant que leurs effets postérieurs sont immédiatement régis par la loi nouvelle (« la loi ne dispose que pour l’avenir », c’est le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle).
Le contrat étant un outil de prévision, les situations juridiques contractuelles sont traitées différemment. La jurisprudence écarte le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle et lui substitut un principe dit de « survie de la loi ancienne ». Tous les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle restent donc en principe régis par la loi en vigueur à l’époque de leur conclusion, aussi bien en ce qui concerne leurs conditions de formation que leurs effets passés et futurs(2). Seuls les contrats conclus après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sont donc, en principe, régis par celle-ci.
Le législateur peut toutefois déroger à ces règles en prévoyant des dispositions transitoires, dans la mesure où l’article 2 du Code civil n’a qu’une valeur légale(3). C’est ce que le Gouvernement a fait avec l’ordonnance du 10 février 2016 dont l’article 9 dispose que :
« Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. »
La disposition n’est pas des plus claires, mais il me semble qu’une interprétation littérale de celle-ci permet de comprendre que :
L’alinéa 1er prévoit que l’ordonnance ne pourra commencer à être appliquée qu’à compter du 1er octobre 2016, c’est ce que l’on vient de voir.
L’alinéa 2 rappelle le principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle : les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent régis par la loi qui était en vigueur au moment de leur conclusion, y compris pour leurs effets postérieurs au 1er octobre 2016. Cet alinéa n’est cependant pas superfétatoire, car s’il existe un principe jurisprudentiel de survie de la loi ancienne en matière contractuelle, la Cour de cassation en a consacré quelques exceptions, elle juge notamment que la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets légaux des contrats conclus avant son entrée en vigueur(4). L’alinéa 2 de l’article 9 de l’ordonnance semble exclure expressément cette exception : l’ordonnance ne s’appliquera pas aux contrats conclus avant le 1er octobre sans que l’on ait à distinguer entre leurs effets contractuels et leurs effets légaux.
L’alinéa 3 consacre trois exceptions au principe de survie de la loi ancienne posé à l’alinéa 2 : l’action interrogatoire en matière de pactes de préférence (art. 1123, alinéas 3 et 4), l’action interrogatoire en matière de représentation (art. 1158) et l’action interrogatoire/en confirmation forcée en matière de nullités (art. 1183) sont applicables « dès l’entrée en vigueur de la présente ». Il faut comprendre par là que ces dispositions seront applicables à tous les contrats, passés comme futurs, à compter du 1er octobre 2016. Cette dérogation au principe de survie de la loi ancienne semble raisonnable dès lors que ces actions interrogatoires visent uniquement à renforcer la sécurité juridique des tiers ou des parties sans déjouer les prévisions initiales de celles-ci. On est ici dans une hypothèse d’application immédiate de la loi nouvelle aux contrats en cours et non dans une hypothèse de rétroactivité puisque les effets produits par les contrats avant le 1er octobre 2016 demeurent régis par la loi ancienne(5).
L’alinéa 4, enfin, précise que l’ordonnance ne s’applique pas aux instances en cours et aux instances introduites avant le 1er octobre 2016. Cet alinéa semble superfétatoire puisque l’alinéa 2 dispose que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent régis par la loi ancienne… La seule hypothèse que pourrait viser cet alinéa est celle dans laquelle une action serait introduite avant le 1er octobre 2016 sur le fondement d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016 et pour laquelle l’une des actions interrogatoires visées à l’alinéa 3 serait exercée, en cours d’instance, après le 1er octobre… L’hypothèse semble hautement improbable.
La tentation de l’interprétation de la loi ancienne à la lumière de la loi nouvelle
En théorie, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 resteront régis par la loi ancienne, hors exceptions visées à l’alinéa 3 de l’article 9 de l’ordonnance. En pratique, on peut se demander si la Cour de cassation ne sera pas tentée de faire évoluer subrepticement son interprétation du droit ancien pour l’aligner progressivement sur le droit nouveau.
Sur certains points le Gouvernement a souhaité « moderniser » le droit des contrats, par exemple en consacrant la cession de dettes. Sur d’autres, le Gouvernement a cherché à codifier à droit constant les solutions jurisprudentielles antérieures pour les rendre plus accessibles, notamment aux juristes étrangers dans l’éventualité d’une uniformisation future du droit des contrats à l’échelle européenne. Pourtant ce travail de codification ne s’effectue pas toujours « à droit constant » car la jurisprudence manquait de clarté sur de nombreuses questions. L’ordonnance opère donc des changements subtils, mais bien réels, du droit positif sur ces questions. Dès lors que ces changements subtils sont généralement motivés par une jurisprudence confuse, il est probable que la Cour de cassation clarifie sa jurisprudence, voire opère des revirements, en s’alignant, sans le dire, sur le texte de l’ordonnance. Cela ne me semblerait pas choquant et me semblerait même parfois opportun, à condition de ne pas opérer de revirements de jurisprudence… pour l’avenir !
Blague à part, il est par exemple acquis en jurisprudence que le pollicitant ne peut rétracter son offre avant l’écoulement du délai dont il l’a assortie, mais la sanction d’une rétractation irrégulière fait l’objet d’un vif débat doctrinal que la Cour de cassation n’a jamais clairement tranché à ce jour. Selon certains, la rétractation irrégulière de l’offre ne peut être sanctionnée que par l’attribution de dommages-intérêts ; pour d’autres, la sanction de l’irrégularité de la rétractation est son inefficacité : la rétractation est considérée comme inefficace et l’acceptation formulée après la rétractation de l’offre, mais avant l’expiration du délai dont elle était assortie, permet de former le contrat. Le nouvel article 1116 du Code civil, introduit par l’ordonnance, dispose en son alinéa 2 que « La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. » Il serait étonnant que la Cour de cassation juge inefficaces les rétractations irrégulières effectuées avant le 1er octobre 2016… Elle va probablement profiter de l’ordonnance pour clarifier sa jurisprudence antérieure en jugeant que la rétractation irrégulière de l’offre, qu’elle soit faite avant ou après le 1er octobre 2016, entraîne la caducité de l’offre et engage simplement la responsabilité de son auteur.
En revanche il est probable que la Cour de cassation ne fasse pas évoluer son interprétation du droit antérieur sur d’autres points, même si elle diverge du droit nouveau. Je pense essentiellement à la jurisprudence Cruz sur la rétractation de la promesse unilatérale de vente. La Cour de cassation a maintenu cette jurisprudence depuis 1993 malgré des critiques doctrinales extrêmement virulentes, il est donc probable que les rétractations de PUV conclues avant le 1er octobre 2016 demeurent efficaces, empêchant le bénéficiaire de la PUV de lever efficacement l’option postérieurement à la rétractation irrégulière. Seules les PUV conclues après le 1er octobre 2016 ne pourront plus être efficacement rétractées avant l’expiration du délai d’option (article 1124, alinéa 2, introduit par l’ordonnance).
La ratification éventuelle de l’ordonnance
L’article 38, alinéa 2, de la Constitution prévoit que les ordonnances « entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation ». Le texte contient une subtilité, souvent exploitée sous la Ve République, qui permet au Gouvernement d’assurer l’efficacité de son ordonnance sans avoir à obtenir sa ratification par le Parlement. L’ordonnance ne devient en effet caduque que si elle n’est pas déposée au Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation, mais la Constitution ne prévoit aucun délai pour sa ratification. Le Gouvernement ayant une large maitrise de l’ordre du jour des assemblées (c’est un peu moins vrai depuis la révision constitutionnelle de 1995 qui a créé une « niche parlementaire »(6)), il peut s’arranger pour que la question de la ratification ne soit jamais débattue au Parlement.
Dès lors, trois hypothèses sont désormais possibles :
Première hypothèse, la ratification de l’ordonnance n’est jamais débattue au Parlement. Dans ce cas l’ordonnance entrera néanmoins en vigueur le 1er octobre 2016, mais aura une valeur réglementaire. En pratique cela signifie que le Conseil constitutionnel ne pourra pas contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance, y compris dans le cadre d’une QPC, mais le Conseil d’Etat sera compétent pour contrôler à la fois sa légalité(7) et sa constitutionnalité(8).
Seconde hypothèse, le Parlement ratifie l’ordonnance, dans ce cas elle acquiert une valeur légale : la loi de ratification pourra être contrôlée par le Conseil constitutionnel. Dans cette hypothèse le Parlement aura la possibilité de modifier l’ordonnance en la ratifiant.
Troisième hypothèse, le Parlement refuse de ratifier l’ordonnance, elle deviendrait alors caduque.
La Garde des Sceaux de l’époque, Mme Taubira, avait annoncé lors des débats sur la loi d’habilitation que l’ordonnance serait soumise à la ratification dans les six mois de sa publication afin que les parlementaires puissent l’amender. Il faut toutefois noter que Mme Taubira a quitté ses fonctions récemment et que les attentats de janvier et novembre 2015 ont eu lieu depuis. Le Gouvernement et le Parlement semblant enlisés dans le débat sur la révision constitutionnelle, il n’est pas certain que la promesse puisse être tenue. Si l’ordonnance peut être débattue au Parlement, il est très peu probable que celui-ci refuse de la ratifier, ce cas de figure ne se produisant jamais(9).
Notes de bas de page :- Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, G. Cornu (dir.), 10e éd., PUF, 2014, v° « vigueur ». [↩]
- Cass. civ. 3e, 3 juill. 1979, n° 77-15.552. Ce principe a encore été rappelé récemment par la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 12 juin 2013, n° 12-15.688. [↩]
- Si le législateur peut déroger à l’article 2 du Code civil, il y a en revanche des limites constitutionnelles et conventionnelles (essentiellement la Convention EDH) de plus en plus importantes à la rétroactivité de la loi. [↩]
- Par « effet légal du contrat » il faut entendre « effet attaché par la loi au contrat », c’est-à-dire un effet que le contrat produit indépendamment de la volonté de ses parties. La Cour de cassation a par exemple jugé en 1981 que l’action directe consacrée par la loi nouvelle en matière de sous-traitance était un effet attaché par la loi au contrat et non un effet contractuel stricto sensu et en a conclu que les dispositions de la loi nouvelle relatives à l’action directe devaient s’appliquer immédiatement aux contrats en cours : Cass. ch. mixte, 13 mars 1981, n° 80-12.125. [↩]
- Une action interrogatoire exercée avant le 1er octobre 2016 ne produirait donc aucun effet. [↩]
- V. le pénultième alinéa de l’article 48 de la Constitution. [↩]
- CE, 12 févr. 1960, Société Eky. [↩]
- Cons. constit., déc. n° 2011-219 QPC du 10 févr. 2012, Patrick E. [↩]
- M. Verpeaux, Droit constitutionnel français, 2e éd., PUF, 2015, p. 571-572, n° 333. Les deux décisions précitées sont extraites de cet ouvrage. [↩]