
Le droit a-t-il vocation à protéger les imbéciles ? Question classique à nouveau posée par un cas d’école qui m’a été récemment présenté par un ami. En l’espèce, une personne visiblement peu scrupuleuse met en vente sur eBay(), depuis plus d’un an, des iPhone « factices » qui sont adjugés au prix de véritables iPhone.
Un téléphone « factice » est une copie non fonctionnelle d’un modèle de téléphone portable, en général destinée à être exposée dans les vitrines des opérateurs. Les anglo-saxons utilisent l’expression « dummy phone » pour désigner ces téléphones factices. En l’espèce, le caractère factice du téléphone apparaît clairement dans l’offre puisque le terme figure dans le titre et dans le corps de l’annonce. Cependant, excepté ce terme, aucun autre élément ne permet de deviner que le téléphone est une copie, une imitation non fonctionnelle. Ainsi, aussi surprenant que cela puisse paraître, de nombreuses personnes enchérissent sans comprendre le terme « factice » et sans chercher à en connaître le sens. On aboutit donc à des situations surréalistes dans lesquelles un téléphone factice est adjugé à plusieurs centaines d’euros. D’après l’historique des ventes de ce vendeur, cette situation cocasse s’est produite à six reprises en un peu plus d’un an, la meilleure vente ayant tout de même atteint 391 euros (capture d’écran disponible ci-dessus). Sachant qu’un iPhone factice s’achète sur Internet à moins de 10$, l’opération est très lucrative pour le vendeur qui peut ainsi dégager une marge brute allant jusqu’à 97,5%…
En pure opportunité, faut-il reconnaître la validité d’un tel contrat de vente ?
Certains insisteront sur la légèreté excessive des acquéreurs, d’aucuns diront leur imbécillité – d’où le titre de ce billet, volontairement provocateur. Sanctionner le vendeur en prononçant la nullité du contrat reviendrait à déresponsabiliser l’acquéreur, à le prendre pour un incapable. Protéger excessivement l’acquéreur, ce serait l’inciter à ne pas réfléchir. Le droit ne devrait donc pas protéger les imbéciles, solution résumée par un adage latin, de non vigilantibus non curat praetor().
D’autres insisteront sur le caractère vicié du consentement, voire sur le comportement du vendeur qui, on le verra, n’est pas à l’abri de tout soupçon.
Face à ces arguments contradictoires, que dit le droit positif français ? La nullité du contrat de vente peut être envisagée sur divers fondements que nous étudierons successivement. Ce n’est qu’une fois les arguments techniques passés en revue que nous pourrons discuter de l’opportunité de la nullité.

La nullité pour erreur
Nul doute que l’erreur sur le caractère factice du téléphone est une erreur sur la substance déterminante du consentement de l’acquéreur. Il est cependant superflu d’aller plus loin dans le raisonnement puisqu’un élément fait évidemment obstacle, en l’espèce, à l’action en nullité : le caractère inexcusable de l’erreur. Même si le caractère inexcusable de l’erreur est parfois conçu de façon très restrictive par faveur pour l’acquéreur lésé(), en l’espèce cette qualification semble inévitable. Le terme « factice », on ne peut plus explicite, figurait de manière bien visible à la fois dans le titre et dans le corps de l’annonce. L’obligation de se renseigner qui pèse sur tout acquéreur impose à la personne normalement prudente et diligente qui ignorerait la signification du terme « factice » de se renseigner avant d’enchérir.
La nullité pour erreur-obstacle
La doctrine distingue l’erreur-vice du consentement (que l’on vient d’envisager) de l’erreur-obstacle. Lorsqu’il y a erreur-obstacle, l’erreur est d’une gravité telle que les consentements n’ont pu se rencontrer, et par conséquent le contrat n’a pu se former. Ce n’est pas un contrat, disait Planiol, c’est un malentendu().
Parmi les deux formes d’erreur-obstacle distinguées par la doctrine, il y a l’erreur sur l’identité de la chose qui a fait l’objet du contrat (error in corpore). Planiol prenait l’exemple de la vente d’un cheval : « tandis que le vendeur voulait se défaire de tel cheval qu’il a actuellement dans son écurie, l’acheteur voulait en avoir un autre. Il n’y a pas de consentement, puisqu’il n’y a pas d’accord »().
La pertinence de la distinction entre erreur-obstacle et erreur-vice du consentement est critiquable et critiquée, il s’agit probablement plus d’une différence de degré que de nature(). Si l’on fait abstraction de ce débat doctrinal, on peut considérer que l’erreur portait en l’espèce non pas sur la substance de la chose (erreur-vice du consentement), mais sur son identité (erreur-obstacle). L’un pensait acheter un véritable iPhone, l’autre vendre un iPhone factice, l’offre et l’acceptation n’ont pu se rencontrer puisque leurs objets étaient différents.
Il est par ailleurs important de relever que certaines ventes ont été, en l’espèce, conclues avec des acquéreurs étrangers non-francophones(). Les acquéreurs étrangers n’étaient alors pas en mesure de comprendre l’objet de la vente du fait de l’utilisation d’un terme complexe dans une langue qu’ils ne maitrisent pas. Le terme « factice » est en effet le seul terme qui, dans l’annonce, permettait de savoir que le téléphone vendu était une imitation. Sans que l’on puisse véritablement considérer ce cas de figure comme une erreur-obstacle stricto sensu, on peut l’y rattacher car plusieurs décisions des juges du fond considèrent qu’il y a alors absence totale de consentement de la part du contractant non-francophone qui ne savait pas à quoi il s’engageait().
Le régime de l’erreur-obstacle est également très discuté, mais il y a un point sur lequel la Cour de cassation s’est prononcé clairement : le caractère inexcusable de l’erreur ne fait pas échec à l’action en nullité en cas d’erreur-obstacle(). Nous aurons l’occasion de discuter un peu plus bas de l’opportunité de cette solution, pour l’instant on se contente de décrire le droit positif et on peut, à ce stade, considérer qu’il existe de sérieux arguments techniques qui permettraient de plaider, en l’espèce, la nullité du contrat de vente pour erreur-obstacle.
La nullité pour dol
Alors que « l’erreur-obstacle chasse l’erreur inexcusable »(), le dol rend l’erreur toujours excusable(). Le dol est le fait de provoquer intentionnellement une erreur chez son cocontractant par des manœuvres, un mensonge ou une réticence. Nous avons déjà caractérisé l’erreur de l’acheteur, il reste donc à prouver l’élément matériel du dol (manœuvres, mensonge ou réticence) et l’élément intentionnel (l’intention de provoquer l’erreur).
Le fait que le caractère factice du téléphone soit expressément mentionné dans l’offre exclut la caractérisation d’une réticence dolosive ou d’un mensonge. Restent donc les manœuvres positives effectuées dans l’intention de tromper le cocontractant.
Une première lecture de l’offre fait apparaître l’absence de telles manœuvres, puisque le terme « factice » est visible dans le titre et dans le corps de l’annonce. Une lecture plus approfondie permet cependant de penser que l’offre pourrait avoir été rédigée avec minutie pour atteindre simultanément deux objectifs : provoquer l’erreur chez le cocontractant d’une part, donner une apparence de légalité d’autre part. L’emploi du terme « factice » ne serait ainsi pas anodin : le terme est suffisamment compliqué pour créer la confusion dans l’esprit de certains acquéreurs potentiels (et donc provoquer l’erreur), suffisamment explicite et visible dans l’annonce pour qu’on ne puisse reprocher au vendeur d’avoir voulu travestir la réalité ou dissimuler l’information.
La même remarque peut être formulée à propos du reste de l’annonce. Il est parfaitement vrai que le téléphone « n’a jamais été exposé ou utilisé », qu’il « est neuf », et que « les films de protection avant et arrière sont encore sur l’écran ». Mais, en pratique, on retrouve plutôt ce type de mentions sur les offres de vente de véritables iPhone, et non sur les offres de vente de modèles factices. Ces mentions, tout en apparaissant comme faisant état d’une réalité indiscutable, contribuent en réalité à provoquer l’erreur chez l’acquéreur du fait du contexte dans lequel elles sont employées.
Une argumentation pourrait donc être développée sur ce point devant un juge : les manœuvres résideraient dans la rédaction d’une offre qui, tout en présentant une apparence de parfaite légalité, serait de nature à provoquer l’erreur chez le cocontractant .
En pratique l’intention dolosive sera extrêmement délicate à prouver, précisément parce que l’apparence indique au contraire l’absence d’une telle intention. Il faut donc dépasser cette apparence, démontrer qu’elle a été fabriquée de toutes pièces par l’auteur des manœuvres dans le dessein de faire échec à une éventuelle action en nullité, voire en responsabilité. On pourra, à cet égard, se baser sur deux éléments en l’espèce. D’une part, le caractère ambivalent des termes employés. Le terme « factice », tout en paraissant explicite et limpide à l’homme instruit, pourra paraître alambiqué et abscons à d’autres. Les mentions utilisées, tout en paraissant, dans l’absolu, fidèles à la réalité, apparaissent comme déceptives dans le contexte dans lequel elles sont employées. D’autre part, on pourra se baser sur le nombre élevé d’acquéreurs victimes d’une erreur. Le vendeur ne pouvait en effet ignorer, à l’issu de la première vente, que si les enchères avaient atteint une telle somme, c’est que l’adjudicataire pensait nécessairement acheter un véritable iPhone (personne ne débourse plusieurs centaines d’euros pour acquérir un iPhone en plastique que l’on peut par ailleurs trouver à moins de 10$ auprès d’autres vendeurs du même site). Si le vendeur n’avait pas l’intention de provoquer l’erreur chez ses cocontractants, il aurait modifié la rédaction de son offre dès la seconde vente pour éviter qu’une telle erreur ne se reproduise.
Une action en nullité pour dol est donc envisageable, même si l’issue du litige semblerait alors assez aléatoire, notamment sur le terrain probatoire. L’action en nullité semble avoir plus de chances de prospérer sur le terrain de l’absence de consentement (erreur-obstacle).
La nullité pour absence de cause objective
La lésion n’est pas, en principe, une cause de nullité en droit français (C. civ., art. 1118). Cependant il est bien connu que la jurisprudence assimile le prix vil ou dérisoire à une absence de prix, et donc à une absence de cause de l’obligation de donner du vendeur qui devient, de ce fait, nulle (C. civ., art. 1131).
Ne pourrait-on pas adopter le raisonnement inverse ? Lorsque la prestation du vendeur est tellement dérisoire par comparaison au prix dû par l’acquéreur, ne peut-on pas considérer que le vendeur n’est en réalité tenu d’aucune obligation, ce qui rendrait l’obligation de l’acquéreur sans cause ?
Bien que moins connue que celle relative au prix vil, il existe une jurisprudence en ce sens. La Cour de cassation reconnaît l’absence de cause en cas de disproportion manifeste entre les contreprestations, c’est-à-dire lorsque l’une des contreparties est dérisoire et, partant, inexistante().
L’opportunité de la nullité
On le voit, il existe des arguments purement techniques qui permettraient au magistrat français, s’il le jugeait opportun, de sanctionner le contrat par la nullité. Il existe cependant des contre-arguments techniques qui laissent une marge de manœuvre suffisante au juge pour ne pas prononcer la nullité, s’il la jugeait inopportune. La question se pose donc : serait-ce opportun de prononcer la nullité en l’espèce ? Question de politique juridique.
La confrontation des intérêts des parties : données psychologiques et données morales ; nullité et responsabilité
Si l’on ne prend en compte que les données psychologiques, alors la nullité du contrat doit être prononcée. Le droit des contrats français repose sur un système consensualiste, le contrat se forme par la rencontre des consentements. Le contrat ne peut donc s’être valablement formé si l’un des consentements est vicié, voire totalement absent.
La nullité du contrat a cependant un effet négatif pour le cocontractant dont le consentement n’est pas vicié. Ce dernier peut être de parfaite bonne foi, peut avoir cru conclure un contrat parfaitement valide, et subir ensuite les effets de la nullité pour vice du consentement. On va donc introduire un facteur moral dans le régime de la nullité pour vice du consentement. Ces données morales vont venir limiter les hypothèses dans lesquelles la nullité peut être obtenue, du moins lorsque le cocontractant est de bonne foi.
C’est notamment le cas, comme on l’a vu, en cas d’erreur inexcusable. L’erreur inexcusable est une faute, le contractant dont le consentement a été vicié n’a pas agi comme l’aurait fait un bon père de famille. Un contractant normalement prudent et diligent aurait cherché à comprendre le sens de tous les termes de l’annonce avant d’enchérir. Dès lors que le comportement de l’errans est jugé moralement répréhensible, on va privilégier les intérêts du cocontractant de bonne foi en ne lui faisant pas subir les effets de la nullité du contrat de vente. Le contrat sera donc maintenu, alors même que le consentement a été vicié, on fera primer les données morales sur les données psychologiques.
La situation change cependant radicalement lorsque le cocontractant est lui aussi fautif, c’est le cas lorsqu’il est l’auteur d’un dol. L’erreur inexcusable a pu, en l’espèce, être provoquée par des manœuvres dolosives. Les deux parties seraient alors fautives : l’une pour avoir commis un dol, l’autre pour ne pas avoir été suffisamment prudente et diligente en contractant. Pour savoir quels intérêts faire prévaloir dans cette hypothèse, il faut se demander quel comportement est, moralement, jugé le plus répréhensible. Il ne fait ici aucun doute : la faute intentionnelle est traditionnellement considérée comme plus grave que la faute de négligence. Une partie a commis volontairement une faute pour induire l’erreur chez son cocontractant, l’autre a simplement péché par excès de naïveté. Il n’y a, dans ce cas de figure, aucune raison de protéger le cocontractant de l’errans, on peut donc prononcer la nullité sans états d’âme.
Le véritable débat sur l’opportunité de prononcer la nullité va donc concerner la question de la nullité pour absence de cause et la nullité pour erreur-obstacle. Dans ces deux cas de figure, la nullité pourra être obtenue peu important le caractère inexcusable, fautif, du comportement de l’acheteur. Est-il opportun de prononcer la nullité du contrat alors même que l’acheteur serait reconnu fautif, et le vendeur de bonne foi ?
De nombreux auteurs considèrent que le caractère inexcusable de l’erreur devrait également s’opposer à l’action en nullité pour erreur-obstacle(). Ces auteurs se fondent sur l’idée de « confiance » que le cocontractant de bonne foi a pu légitimement fonder sur le contrat. Le cocontractant « a pu légitimement croire qu’il traitait avec un partenaire prudent et diligent »().
Cependant, ce raisonnement ne conduit-il pas à mélanger deux concepts élémentaires du droit français des obligations, celui de la nullité et celui de la responsabilité civile ? La responsabilité civile répare un préjudice qui peut notamment avoir été causé par une faute. La nullité annule rétroactivement les effets d’un acte juridique dont l’une des conditions de formation n’a pas été respectée. Introduire la notion de faute dans le régime de la nullité, c’est brouiller les frontières entre ces deux notions fondamentales du droit des obligations.
On pourrait pourtant mobiliser successivement les deux notions dans notre espèce tout en maintenant l’étanchéité des deux régimes et en aboutissant à un résultat équitable pour chaque partie. Nous pourrions ainsi, dans un premier temps, prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement, absence totale de consentement ou absence de cause. Puis, dans un second temps, nous pourrions recourir à la responsabilité civile pour réparer le préjudice subi par le cocontractant de bonne foi du fait de l’annulation du contrat. Il s’agirait d’une responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la faute résidant dans la négligence de l’errans (caractère inexcusable de son erreur).
Le gain que le vendeur pouvait espérer de l’exécution du contrat pourrait alors constituer un préjudice réparable. Il faudrait évidemment évaluer cette espérance de gain non pas sur la base du contrat annulé, mais sur la base des conditions auxquelles le contrat aurait vraisemblablement été conclu avec un acquéreur qui n’aurait pas commis d’erreur. Il est évident qu’un acquéreur normalement prudent et diligent n’aurait pas fait monter les enchères pour la vente d’un iPhone factice jusqu’à 391 euros. La marge brute dont le vendeur pourrait prétendre être indemnisé serait donc bien inférieure, pour la calculer il faudrait se référer au prix moyen auquel les iPhone factices sont adjugés sur le même site, eBay.
La nullité sanctionne un défaut de formation du contrat (sanction objective), la responsabilité civile pour faute sanctionne le comportement du cocontractant (sanction subjective). Cette théorie a priori séduisante, défendue par quelques auteurs(), évite d’avoir à intégrer la notion de faute dans le mécanisme de la nullité, notion qui lui est en principe étrangère.
Cette théorie soulève tout de même une problématique que l’on n’a pas encore évoquée : les conséquences de la nullité sur les tiers.
L’intérêt des tiers : la sécurité juridique
Annuler le contrat de vente et réparer le préjudice du vendeur permet a priori d’obtenir une solution équitable pour l’acquéreur comme pour le vendeur. Mais quid des tiers ? L’annulation trop aisée des contrats est en effet source d’insécurité juridique. La confiance que les tiers ont pu légitimement fonder sur ces contrats est sacrifiée.
Sans entrer dans les détails, on se contentera d’indiquer qu’il existe des mécanismes qui pourraient être à même de pallier le risque d’insécurité juridique. Il y a notamment la notion d’apparence qui peut permettre de fonder les contrats subséquents conclus sur la foi du contrat annulé.
Et l’apparence n’est pas la panacée. Ainsi, si l’iPhone factice venait à être revendu en l’espèce, le sous-acquéreur serait protégé par le jeu de l’article 2276 al. 1er du Code civil (« En fait de meubles, la possession vaut titre »). La restitution du bien vendu consécutive à l’annulation rétroactive du contrat de vente initial se ferait alors par équivalent : l’acheteur devrait restituer la valeur de l’iPhone factice qui est bien inférieure au prix payé.
Ajoutons enfin la garantie d’éviction qui protège, dans de nombreux contrats, les ayants-cause à titre particulier.
L’insécurité juridique susceptible d’être créée par l’annulation du contrat de vente ne semble donc pas être un argument rédhibitoire à l’encontre de cette théorie.
En conclusion on peut répondre que le droit est à même de protéger à la fois les imbéciles (nullité du contrat de vente), le cocontractant à qui l’imbécile a, par sa légèreté fautive, causé un préjudice (responsabilité civile), et les tiers (apparence, 2276 al. 1er, garantie d’éviction, etc).
Notes de bas de page :


 La position de la chambre criminelle de la Cour de cassation est désormais claire. Celle-ci avait en effet cassé en 2010 l’arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu que le préposé, « en conduisant un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, (…) n’a pu qu’excéder les limites de la mission qui lui avait été impartie »(
La position de la chambre criminelle de la Cour de cassation est désormais claire. Celle-ci avait en effet cassé en 2010 l’arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu que le préposé, « en conduisant un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, (…) n’a pu qu’excéder les limites de la mission qui lui avait été impartie »(
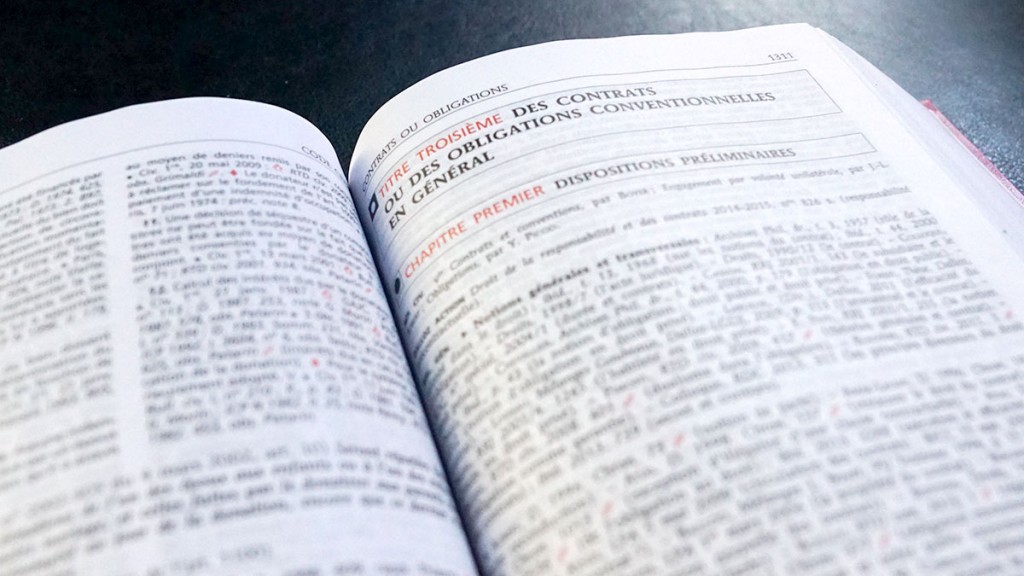 Alors que l’on pensait les dernières velléités de réforme enterrées et que l’on enseignait aux étudiants qu’une période de crise économique était peu propice à une réforme du droit des obligations, trop éloignée des préoccupations du citoyen profane, le Gouvernement semble avoir pris beaucoup de monde de court en déposant, il y a quelques jours, un ambitieux projet de loi visant à réformer de nombreux pans du Code civil(
Alors que l’on pensait les dernières velléités de réforme enterrées et que l’on enseignait aux étudiants qu’une période de crise économique était peu propice à une réforme du droit des obligations, trop éloignée des préoccupations du citoyen profane, le Gouvernement semble avoir pris beaucoup de monde de court en déposant, il y a quelques jours, un ambitieux projet de loi visant à réformer de nombreux pans du Code civil(

